
Monuments et sites remarquables
-
La Basilique-Cathédrale
-
Le Musée d'art et d'histoire Paul Eluard
-
L'Unité d'archéologie et la Fabrique de la ville
-
Le couvent des Ursulines
Les Ursulines, qui ont fait construire ce bâtiment, s'y sont installées à partir de 1641. C’est dans ce couvent, situé rue des Ursulines, que le jeune roi Louis XIV et sa mère, Anne d'Autriche, logèrent en 1652, au cours de leur séjour à Saint-Denis pendant la Fronde. L’Assemblée Nationale ayant décrété la suppression des communautés religieuses et l’évacuation des maisons pieuses, en 1792, les religieuses quittèrent les lieux. Seule subsista, jusqu'en 1822, l'école pour jeunes filles qui ferma lorsque la Mère parent ne fut plus en mesure de la diriger du fait de son grand âge. Le couvent changera ensuite plusieurs fois de fonction et de propriétaires. Hôpital militaire puis siège de la sous-préfecture, il fut vendu à la fin du XIXe siècle et abrite aujourd'hui des habitations privées.
-
La Maison aux masques
L’immeuble du 46 rue de la Boulangerie relève d’un type architectural caractéristique du début du XVIIIe siècle. Longtemps désaffectée, la maison aux Masques a été inscrite au titre des Monuments historiques en 2006, avant de bénéficier d’une importante réhabilitation achevée en 2010.D Derrière sa façade sur laquelle sont visibles quatre masques figurant les saisons, ont été conçus des appartements ainsi que des locaux commerciaux, au rez-de-chaussée.
-
La Maison d'éducation de la Légion d’honneur
La Maison d'éducation de la Légion d’honneur n’est pas une école comme les autres. Depuis l’institution de l’Ordre nationale de la Légion d’honneur, le 19 mai 1802, Napoléon songeait à doter ses membres d’une aide sociale. Désirant donner une bonne éducation des filles de décorés, l’empereur décida l’ouverture d’établissements publics pour leur instruction.
Située dans l’ancienne abbaye de Saint-Denis, cette école publique et laïque française est un lycée de filles qui accueille également des classes d'hypokhâgne-khâgne et de BTS. Les jeunes filles sont toutes internes et portent un uniforme. Cet établissement est reconnu pour l’excellence de son enseignement et le taux de réussite au baccalauréat y est remarquable.
-
La maison des Arbalétiers
En 1722, Rodolphe Ebinger, ancien ouvrier d’Oberkampf, le célèbre fabricant de toiles peintes de Jouy-en-Josas, crée une manufacture établie en bordure du Croult. Les opérations de lavage, d’impression et séchage liées à la confection des toiles peintes, nécessitaient la proximité d'une eau abondante et des locaux spacieux. Le bâtiment, situé au 9 rue Auguste Blanqui, semble tirer son nom des « arbalétriers », les pièces inclinées supportant les versants du toit dans une ferme de charpente.
-
La cité du cinéma
Quand Saint-Denis rivalise avec Hollywood
Inaugurée le 21 septembre 2012, la Cité du cinéma imaginée par Luc Besson a trouvé son écrin Carrefour Pleyel, dans une ancienne centrale thermique (Saint-Denis II), bâtie à la fin des années 1920 par la Société d'électricité de Paris pour alimenter et éclairer le jeune métropolitain parisien.
Aujourd'hui, cette cathédrale du cinéma à l'imposante nef de verre et de métal regroupe, en un même lieu, toutes les ressources humaines, techniques et logistiques nécessaires à la réalisation d'un film : écriture du scénario, production, construction de décors, confection de costumes, studios de tournage, post-production et salle de projection.
Apprendre un métier à la cité
La cité a également pour ambition de devenir une pépinière de talents et de compétences. C'est la raison pour laquelle elle abrite trois écoles de cinéma :
L'École Louis-Lumière, grande école publique dédiée aux métiers du cinéma, de la photographie et du son, qui a vu le jour en 1926 sous l’impulsion de figures telles que Louis Lumière ou Léon Gaumont, et a rejoint la cité en 2012.
L' École de la Cité, imaginée par Luc Besson, ouvertes aux jeunes de 18 à 25 ans, et pour laquelle l'esprit créatif des candidats est le principal critère de recrutement. Elle propose deux formations : auteur/scénariste et réalisateur.
La N.E.F. des acteurs, qui propose depuis 2015, des formations au métier d'acteur au cœur de la cité.
Les élèves de ces trois écoles, en contact permanent avec les professionnels qui travaillent dans la cité, sont donc en totale immersion et peuvent travailler en synergie les uns avec les autres.
Visiter l'envers du décors
La Cité du cinéma dévoile une partie de ses secrets aux visiteurs qui souhaitent la découvrir à travers des visites guidées, organisées sur réservation.
• e-mail : visites@cultival.fr
• Tél : 0825 05 44 05 (0,15€/min)
• Site : www.cultival.fr
La cité accueille également des expositions temporaires autour de « phénomènes » cinématographiques. Au cours des dernières années, les amateurs ont ainsi pu s'offrir une plongée dans l'univers de Star Wars et de Harry Potter.
Contactez nos services
Office de Tourisme Plaine Commune Grand Paris
1 Rue de la République
93200 Saint-Denis
France
Lundi au dimanche : de 9h30 à 18h
Jours fériés :10h à 14h
Fermé les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai
Plus d'informations : www.tourisme-plainecommune-paris.com
Plus d'informations : www.tourisme-plainecommune-paris.com
À lire aussi
-
 La Micro-Folie de Saint-Denis
La Micro-Folie de Saint-DenisLa Ville de Saint-Denis s'est dotée d'une Micro-Folie itinérante, projet ayant comme ambition de faciliter l’accès à la culture au plus grand nombre.
-
L'Académie Fratellini
Implantée à Saint-Denis, à deux pas du Stade de France, l’Académie Fratellini est l’héritière de l’École nationale du cirque, fondée par Annie Fratellini, et un lieu…
-
Le Festival hip-hop et des cultures urbaines de Saint-Denis
Le Festival hip-hop et des cultures urbaines met à l’honneur chaque année, depuis 1990, pendant 2 semaines, toutes les facettes des cultures urbaines : rap, slam, graff’…
-
 Festival de Saint-Denis et Métis
Festival de Saint-Denis et MétisLe Festival de Saint-Denis a lieu tous les ans au mois de juin, depuis 1968. Il propose de grands concerts classiques, symphoniques et choraux dans la Basilique de Saint…
-
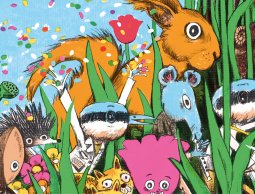 La Fête des tulipes
La Fête des tulipesDans le magnifique cadre du parc de la Légion d’honneur, la Fête des tulipes est un rendez-vous culturel dionysien incontournable. Appréciée pour sa très grande…
-
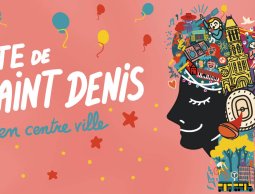 La Fête de Saint-Denis
La Fête de Saint-DenisLa Fête de Saint-Denis est le rendez-vous culturel et populaire de la rentrée qui met en avant les associations dionysiennes.
-
 Activités et lieux culturels
Activités et lieux culturels -
 Parcours historique dans la ville
Parcours historique dans la villeVingt bornes sculptées dans le métal, œuvres originales du plasticien Jean Kiras, relient la Basilique au Stade de France.
-
 Street Art Avenue
Street Art Avenue5 kilomètres dédiés au street-art le long du canal Saint-Denis entre La Villette à Paris et la Porte de Paris à Saint-Denis, c’est l’idée de Street art avenue. Le projet…
-
 Éducation artistique et culturelle pour les scolaires
Éducation artistique et culturelle pour les scolairesLa Ville de Saint-Denis propose aux enseignants du primaire plusieurs outils et dispositifs pour accompagner les élèves dans la pratique, la rencontre et la connaissance…

